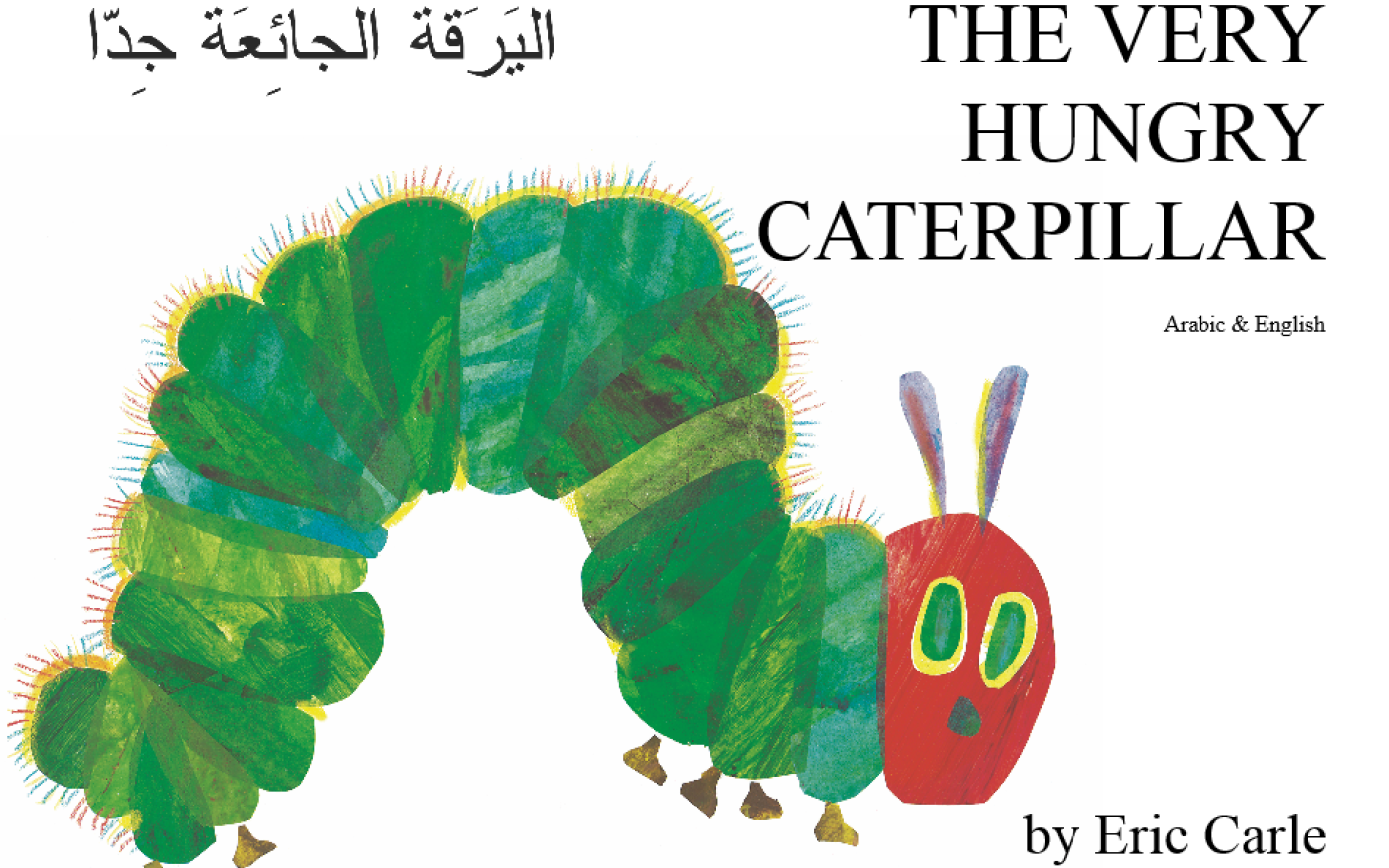« Parler avec nos propres mots » : des familles réinventent le plaisir de la lecture en arabe

Faire la lecture aux plus petits ne devrait jamais être une corvée. Mais le plaisir qu’un enfant peut tirer d’un livre est certainement gâché s’il n’en comprend pas la langue.
C’est un problème auquel sont confrontés les parents du monde entier, mais pour les locuteurs de la langue arabe, les difficultés sont accrues par le fait que les livres pour enfants sont écrits dans un standard formel très différent de la langue parlée. Une poignée de pionnières tentent néanmoins de pallier ce problème en ouvrant une voie nouvelle en dialecte.
Riham Shendy, 45 ans, est l’une d’entre elles. Elle a commencé à traduire des livres de contes populaires anglais en arabe égyptien après la naissance de ses jumeaux, Ali et Leila, en 2013. Économiste de profession et titulaire d’un doctorat en économie appliquée, elle travaillait à la Banque mondiale à Washington D.C. quand elle et son mari allemand, Steffen Reichold, ont décidé d’enseigner à leurs enfants leurs langues maternelles respectives.
Si certains livres populaires pour enfants ont été traduits en arabe classique, comme Gruffalo de Julia Donaldson et La Chenille qui fait des trous d’Eric Carle, il est rare de les trouver en aamiya (ou darija), le dialecte arabe parlé au quotidien. Ainsi, même les noms des aliments que la chenille croque sur son passage ne correspondent pas au vocabulaire que les parents enseignent à leurs enfants.
Ainsi, la collection de livres pour enfants en arabe que Riham Shendy avait fièrement réunie était en arabe standard moderne, également appelé arabe littéraire, classique ou fousha, une version formelle de l’arabe principalement utilisée dans les communications officielles, les médias et la littérature.
Les langues parlées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont des dialectes de cette forme, uniques à chaque pays. Les variations régionales en matière de vocabulaire et de grammaire sont telles qu’ils sont parfois incompréhensibles au-delà des frontières.
« Dès lors que vous traduisez mot à mot quelque chose qui rime en fousha, vous changez la structure de la phrase, vous changez les mots, vous perdez la rime »
- Riham Shendy, auteure
Dans les premiers temps, explique Riham Shendy, faire la lecture à ses enfants était simple : « Au début, vous ouvrez un livre, c’est juste une pomme ici, une banane là-bas. Ça va. »
Mais quand les jumeaux ont été âgés d’un an et demi environ, les choses se sont compliquées. Il n’y a pas de meilleur moyen de retirer tout plaisir à la lecture que de traduire simultanément chaque page de l’arabe formel au dialecte.
« Je parle couramment l’arabe classique, j’ai grandi en Égypte », explique Riham. « Mais dès lors que vous traduisez mot à mot quelque chose qui rime en fousha, vous changez la structure de la phrase, vous changez les mots, vous perdez la rime. » C’est pourquoi, dit-elle, les livres du Dr Seuss sont si utiles pour les enfants – car ils les aident à comprendre la structure sonore du langage.
« Parfois, quand je leur faisais la lecture, j’oubliais de dire quelque chose et ils le remarquaient : ‘‘Mais tu n’as pas dit qu’il était triste’’... Oh oui, c’est parce que j’ai inventé ça quand je traduisais la dernière fois, répondais-je. »
Pour éviter d’être prise à nouveau en flagrant délit, Riham a traduit certaines des histoires préférées de ses enfants en dialecte égyptien, tâchant minutieusement de préserver le rythme et la rime. Elle a ensuite imprimé ses traductions et les a collées sur les mots anglais.
Cinq ou six livres plus tard, en novembre 2016, Riham a publié ses traductions sur un site web, qu’elle a appelé Tuta Tuta, d’après une expression arabe traditionnellement utilisée pour terminer une histoire. À mesure qu’augmentait la popularité du site, elle a commencé à jouer avec le format, à publier des vidéos d’elle en train de lire des histoires, ainsi qu’à proposer des fichiers audio téléchargeables.
Mais tout ce travail devenant chronophage, Riham a décidé de prendre contact avec des éditeurs pour voir s’ils seraient susceptibles d’imprimer des livres en dialecte arabe.
« J’étais à court de livres », se souvient-elle. « Je ne peux pas créer un livre chaque fois que je veux le lire. J’ai écrit [aux éditions] Macmillan, Ladybird. Personne ne m’a répondu. Évidemment, car je ne suis personne. »
Jongler entre le dialecte et l’arabe littéraire
Pour Riham, il n’y avait alors qu’une solution : faire cavalier seul. Grâce à ses antécédents universitaires, cette crack en informatique autodidacte a passé dix mois à rassembler de la documentation pour soutenir son projet. Le résultat a été un article académique, intitulé The Limitations of Reading to Young Children in Literary Arabic (les limites de la lecture aux jeunes enfants en arabe littéraire).
« De nombreuses recherches ont montré que les avantages de la lecture à haute voix pour les jeunes enfants vont bien au-delà du développement de leurs compétences en langue », y écrit Riham Shendy, faisant référence aux « locuteurs au sein d’une seule communauté (nation) [qui] utilisent simultanément deux variétés d’arabe […] Faire la lecture aux enfants joue un rôle important dans l’amélioration de leur développement émotionnel, social et cognitif. »
Bien que son article ait ensuite été publié par une revue universitaire, cela ne l’a pas fait progresser davantage dans ses projets. En mars 2019, elle a proposé un livre de contes à des éditeurs égyptiens, mais publier quelque chose qu’ils ne pourraient pas commercialiser dans le reste de la région ne les intéressait pas.
Marcia Lynx Qualey, traductrice de littérature arabe pour enfants et co-fondatrice du projet World Kid Lit, spécialisé dans les ouvrages en langue étrangère, explique que les éditeurs pour enfants sont dans une position difficile.
« Il est demandé aux enfants arabes de surmonter des obstacles auxquels aucun autre enfant au monde ne doit faire face – à savoir, apprendre leurs matières sans maîtriser entièrement la langue dans laquelle ces sujets sont écrits »
- Niloofar Haeri, anthropologue linguistique
« Même s’ils peuvent vouloir publier des livres en aamiya, ils veulent aussi vendre sur un marché aussi large que possible. Cela signifie pouvoir vendre au-delà des frontières, en particulier dans les pays plus riches du Golfe, et cela signifie également vendre aux écoles et aux bibliothèques. Généralement, seuls les livres entièrement en fousha sont considérés comme étant ‘‘correctement’’ pédagogiques. »
À cet égard, les lecteurs arabes sont mal servis : ils doivent apprendre les deux formes de la langue et basculer entre les deux – même s’ils n’ont pas encore appris à lire ou à écrire tout seuls.
Niloofar Haeri, anthropologue linguistique à l’Université John Hopkins, a écrit en 2003 dans Sacred Language, Ordinary People (langue sacrée, personnes ordinaires) qu’« il est demandé aux enfants arabes de surmonter des obstacles auxquels aucun autre enfant au monde ne doit faire face – à savoir, apprendre leurs matières sans maîtriser entièrement la langue dans laquelle ces sujets sont écrits. »
En avril, Riham Shendy a publié par ses propres moyens Kan ya ma kan (il était une fois), une anthologie de huit histoires populaires pour enfants, traduites par ses soins. Des contes comme Mika al-ahmarika (le petit chaperon rouge) y sont non seulement racontés en dialecte égyptien, mais également dotés de l’habillage culturel nécessaire pour enseigner aux enfants leur patrimoine.
Dans la version de Riham, Mika (le petit chaperon rouge) porte une fatir (une galette égyptienne), au lieu d’une tarte, à sa grand-mère souffrante, qui vit dans la ville oasis de Fayoum, près de la seule cascade d’Égypte à Wadi al-Rayyan.
Riham a inclus dans son histoire des faits amusants pour générer des sujets de discussion avec les enfants, mais aussi pour introduire des concepts tels que le respect de l’environnement.
Bien que les loups ne soient pas courants en Égypte, Riham a situé l’histoire à Fayoum après avoir découvert qu’un animal de cette espèce avait été trouvé et relâché là-bas en 2018 par le ministère de l’Environnement.
De même, sa version du Vilain Petit Canard se déroule dans la ville de Sohag, en Haute-Égypte, où le palmipède se cache au milieu des plantations de canne à sucre ; les femmes du Pot magique portent quant à elles des vêtements bédouins et cuisinent du belila, une bouillie égyptienne à base de blé, plutôt que du porridge ; et dans sa version des Trois Petits Cochons, située dans le désert occidental égyptien, le loup tombe dans un immense bol de mloukhia verte, un ragoût égyptien à base de feuilles de jute.
« Je ne savais pas au début que j’allais situer les histoires dans différents gouvernorats [égyptiens], mais je me devais d’ajouter une certaine profondeur », explique Riham Shendy. « Ainsi, vous ne faites pas que réécouter Le Petit Chaperon rouge, vous l’écoutez désormais à Fayoum avec sa maman qui ressemble à une maman typique de Fayoum. »
Même Le Caire fait une apparition à mi-chemin du recueil, alors que le petit bonhomme de pain d’épices tente de fuir ses poursuivants avant d’être finalement englouti devant un décor spectaculaire de pyramides.
Publier dans le monde arabe
En 2012, la journaliste palestinienne Reem Makhoul a déménagé à New York avec son mari, Stephen Farrell. Originaire de Galilée, Reem, comme Riham Shendy, a changé de casquette et fait une pause dans sa carrière quand elle a eu Sheherazade, sa première fille.
Son mari étant irlandais, il incombait à Reem d’initier leur fille à la langue arabe et à l’identité qui lui était si chère.
« Je veux que ma fille connaisse la langue de sa musique, de sa nourriture, de sa culture, de ses vêtements, des conversations dans le village. Vous savez, ses grands-parents, les plantes que nous semons dans la terre », confie-t-elle à Middle East Eye.
« Je veux qu’elle puisse communiquer avec eux dans leur propre langue, sa propre langue en fait, vu qu’elle est à moitié palestinienne. »
« J’ai commencé à lui lire des livres en arabe que des amis et membres de la famille m’apportaient de Palestine, du Liban et de Jordanie », raconte-t-elle. Mais Reem n’arrivait pas à retrouver le flux de la narration orale en arabe.
« Je devais lire l’histoire en fousha dans ma tête, chaque page, puis la traduire en arabe parlé pour qu’elle comprenne les mots. C’était vraiment dérangeant. Ça ne me semblait pas naturel. Ça coupait le rythme de la lecture pour moi et pour elle. »
Reem s’est retrouvée confrontée au même problème que Riham : il n’existe pas de livres pour enfants en dialecte arabe. Tout comme Riham, Reem a alors adopté le système D – mais au lieu de retravailler un livre existant, elle a décidé d’en créer un à elle.
Une nuit de 2014, après avoir couché Sheherazade, qui avait alors près de 4 ans, Reem a dit à son mari : « Je sais exactement ce que nous devons faire : écrire des histoires pour les enfants en arabe. »
Le couple a créé une maison d’édition qu’il a appelée Ossass Stories (ossass signifie « histoires » en dialecte levantin, lequel est parlé en Palestine, en Syrie et au Liban), apprenant le métier à partir de zéro et finançant eux-mêmes le projet.
Reem travaillait de jour en tant que journaliste et faisait la nuit des recherches sur l’industrie de l’édition, établissant des analyses de coûts et tentant de trouver des illustrateurs et des points de distribution.
« J’étais tellement excitée que j’avais l’impression que c’était notre vocation de faire ça », s’enthousiasme-t-elle, se souvenant qu’elle restait parfois debout jusqu’à trois heures du matin pour chercher des livres écrits en arabe dialectal.
« J’ai été très surprise de n’en trouver aucun parce que je pensais qu’il y avait certainement plein de gens comme moi qui y avaient déjà pensé, qui étaient passés par les mêmes étapes que moi. Mais comment était-ce possible qu’il n’y ait pas de livres comme ça ?! »
Le premier livre qu’ils ont publié, en 2015, s’intitule Al-Bint illi dayyaat khayyal-ha (la fille qui a perdu son imagination). Située à New York, l’histoire tire son inspiration de la vive imagination de Sheherazade elle-même et est écrit en dialecte levantin.
Depuis, la famille a déménagé à Jérusalem. En 2017, Ossass Stories a publié un deuxième livre, Wen biddi atkhabba (où vais-je me cacher ?). Les deux ouvrages sont désormais disponibles en arabe levantin et égyptien.
« Enseigner l’arabe à ma fille est un cadeau pour la vie. Elle aura davantage d’opportunités culturelles et professionnelles à l’avenir », estime Reem. « Et moi, je veux juste qu’elle me parle dans ma propre langue et que je lui parle dans ma propre langue. »
Manque de ressources pédagogiques
Le problème du matériel de lecture pour les très jeunes enfants qui apprennent l’arabe est universel. Mais le manque de ressources pédagogiques adaptées à cet âge est ressenti plus fortement encore par les parents qui élèvent leurs enfants en dehors du monde arabe.
Saussan Khalil, professeure de langue arabe à l’Université de Cambridge et mère de deux enfants, en sait quelque chose : « Vous ne l’avez pas [la langue] autour de vous. C’est pour ça que c’est un si grand problème pour nous [qui vivons] en dehors des communautés arabophones, car nos enfants ne sont pas exposés [à la langue].
« Ils ne l’apprennent pas à la maison. Vous ne pouvez pas, l’exposition est trop faible à la maison par rapport à l’exposition [à l’anglais] à l’école. »
La Britanno-Égyptienne a déménagé à Cambridge en 2014, lorsque sa première fille Noura avait deux ans et demi. Loin de la communauté égyptienne, elle craignait que Noura ne comprenne jamais complètement sa langue maternelle.
Saussan et son amie Mona El-Kheshen ont bien essayé d’emmener leurs enfants à des groupes arabes locaux, mais elles ont trouvé que les cours pour débutants qu’ils offraient étaient trop axés sur l’écriture.
« Le problème est que l’arabe standard n’est parlé nulle part. C’est une norme idéologique ou théorique. Et c’est donc là que se posent les problèmes linguistiques et pédagogiques. Vous créez en quelque sorte du matériel et des scénarios artificiels »
- Saussan Khalil, enseignante
« C’est en fait Mona qui a eu l’idée. ‘’Saussan, m’a-t-elle dit, tu es enseignante, apprends [leur] l’arabe.’’ Comme on dit, la nécessité est mère de l’invention… »
Saussan a créé un petit groupe hebdomadaire, composé au début uniquement de sa fille, des deux enfants de son amie Mona et de la fille du voisin espagnol de Saussan, passionnée par l’Égypte ancienne et désireuse d’en apprendre la langue.
L’approche de Saussan était unique, proposant des cours entièrement en arabe vernaculaire. Plus récemment, elle a introduit l’apprentissage de type phonétique.
Nommée Kalamna (nos mots), son école accueille aujourd’hui une soixantaine d’élèves, du bébé à l’adulte, y compris des enfants syriens qui ont fui leur pays et dont les parents veulent qu’ils conservent leur langue maternelle.
Néanmoins, la rareté des ressources pour tous les âges continue d’être un problème. « Les comptines et dessins animés, des choses comme ça, sont tous doublés en arabe standard, c’est très frustrant », déplore l’enseignante.
Celle qui se décrit comme « une entrepreneure réticente » propose désormais des cours de perfectionnement aux personnes souhaitant enseigner l’arabe selon la méthode Kalamna et a récemment lancé sa première franchise.
« Le problème est que l’arabe standard n’est parlé nulle part », souligne Saussan. « C’est une norme idéologique ou théorique. Et c’est donc là que se posent les problèmes linguistiques et pédagogiques. Vous créez en quelque sorte du matériel et des scénarios artificiels. »
Les apprenants, dit-elle, sont ainsi découragés car ils ne peuvent pas utiliser la langue pour parler aux gens.
« On se moque d’eux... c’est très frustrant pour eux. »
Le Gros Navet
En 2016, Saussan a contacté Reem Makhoul après avoir découvert Ossass Stories et commandé une copie de son premier livre. Plus tard, elle s’est entretenue avec Riham Shendy de la façon d’ajouter ses traductions arabes dans des livres de contes en anglais.
« Cela semble vraiment extrême maintenant, mais je me souviens de la force avec laquelle je ressentais à l’époque l’envie d’un livre en arabe ! Et je suppose que Riham ressentait exactement la même chose, et c’est comme ça qu’elle a eu l’idée. Et une belle amitié est née », se remémore Saussan.
À partir de ce moment-là, les trois femmes ont communiqué « en permanence », principalement par courrier électronique et sur les réseaux sociaux. En février 2019, Saussan a créé le groupe The Spoken Arabic Initiative sur Facebook, en tant que forum pour discuter de leurs projets, de leurs obstacles et « trouver du soutien et des encouragements quand nous avons juste envie d’abandonner ».
Les trois femmes – basées aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient – se sont finalement rencontrées en personne au cours de l’été 2019 après avoir découvert qu’elles seraient toutes à Londres ou à proximité en même temps.
« Nous avions l’impression de nous connaître depuis toujours et nous avions du mal à croire que nous ne nous étions jamais rencontrées avant », se souvient Saussan.
Lors d’une soirée d’été venteuse à Hyde Park, dans la capitale britannique, elles ont partagé histoires et conseils tout en marchant. Cette rencontre a également poussé Riham à décider de produire sa propre anthologie.
« Saussan m’a dit : ‘’Fais le livre…’’ et je lui ai répondu : ‘’ Non, je ne le ferai pas. Personne ne l’achètera’’. »
Les trois femmes étaient tellement absorbées par leur conversation qu’elles ont raté la fermeture du parc et se sont retrouvées enfermées à l’intérieur.
« Nous hurlions, à Hyde Park, moi, elle et Reem », se souvient Riham. « Et puis la deuxième semaine de septembre, je me suis dit : ‘’D’accord, je fais le livre’’. »
Après l’avoir poussée à franchir le pas, Saussan a aidé Riham à approfondir sa réflexion académique sur le projet et Reem lui a donné des conseils en matière d’illustration, d’impression et de distribution, en fonction de sa propre expérience. « Reem m’a beaucoup aidée car elle avait le savoir-faire. »
Le livre de Riham Shendy s’ouvre sur une adaptation égyptienne du conte populaire russe Le Gros Navet, qui semble symboliser la lutte des trois femmes. Ateya, un fermier, est aidé par sa famille et quelques animaux de passage pour récolter un navet géant qui a poussé à partir de rangées de minuscules graines qu’il avait plantées.
Puis, ensemble, ils ont tiré et tiré encore, jusqu’à ce que, tout à coup, le navet jaillisse du sol.
Le mois suivant, chaque fois qu’ils avaient faim, ils se rassemblaient à table et mangeaient une portion du navet qu’ils avaient arraché ensemble.
Le livre de Riham s’est bien vendu en Égypte et la livraison est désormais disponible aux États-Unis, tandis que le reste du monde suivra bientôt. Elle a également lancé une série de vidéos sur Facebook sur l’importance de la lecture, basées sur des recherches scientifiques citées.
« C’est vraiment un cri pour que les gens voient ça », commente Riham. « Nous en avons besoin et personne ne veut le faire.
« Je ne dis pas que nous devrions faire de l’aamiya pour toujours et pour tout le monde. Je dis juste pour les petits – ils ne vont même pas encore à l’école.
« Pour moi, ce livre parle de ça : est-ce que quelqu’un ressent la même douleur que moi ? »
Kan ya ma kan est publié par Tuta-tuta.com.
Al-Bint illi dayyaat khayyal-ha et Wen biddi atkhabba sont disponibles en arabe levantin et égyptien (éditions Ossass Stories).
Les cours Kalamna sont actuellement disponibles en ligne en réponse aux réglementations liées à la pandémie de COVID-19.
Traduit de l’anglais (original).
Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].